Procédure de redressement judiciaire : l’essentiel
2 mois de compta offerts
Lorsqu’une société en difficulté ne parvient plus à faire face à ses dettes, elle peut bénéficier d’un mécanisme de protection encadré par le droit français : la procédure de redressement judiciaire. Ce dispositif vise à donner une seconde chance aux entreprises en cessant momentanément l’exigibilité des dettes pour leur permettre de restructurer leur activité, préserver les emplois et éviter une liquidation judiciaire. Quelles sont les étapes clés du redressement ? Quels droits pour les créanciers ? Comment se construit un plan viable ? Voyons justement chaque étape de cette procédure, ses conséquences, les alternatives possibles, ainsi que les droits et obligations des différents acteurs impliqués.


Qu’est-ce que le redressement judiciaire ?
La procédure collective de redressement est souvent perçue comme une ultime tentative de survie pour les entreprises en difficulté. Pourtant, elle peut aussi représenter une opportunité de restructuration stratégique si elle est bien encadrée. Avant d'en explorer les rouages, il convient de poser un cadre clair sur sa nature, ses objectifs et son déroulement.
Définition du redressement judiciaire
En droit français, la procédure collective de redressement est une procédure collective ouverte par décision d’un tribunal de commerce ou judiciaire à l’égard d’une entreprise en état de cessation des paiements, mais dont le but est de poursuivre l’activité. Autrement dit, lorsque la société n’est plus en mesure de régler son passif exigible avec son actif disponible.
La procédure de redressement judiciaire est encadrée par les dispositions du Code de commerce, notamment les articles L. 631-1 et suivants. L'apurement du passif est l'objectif premier de cette démarche. A cela s'ajoutent le maintien de l’emploi et la pérennité de l’activité.
Pendant la procédure, les droits des associés d’une société, des dirigeants de la société et des créanciers sont encadrés afin de préserver au mieux l’intérêt collectif.
Quel est le but de la procédure collective de redressement ?
La procédure collective de redressement a pour objectifs de :
- permettre à l’entreprise de poursuivre son activité économique ;
- protéger les emplois et assurer la continuité des contrats de travail ;
- mettre en place un plan de redressement pour rembourser, dans la mesure du possible, l’ensemble des créanciers.
Le juge-commissaire et les administrateurs judiciaires vont analyser l’état de la situation de l’entreprise et évaluer les possibilités de redressement.
Cette période constitue une phase stratégique car elle conditionne la décision de poursuite de l’activité.
L’un des objectifs du législateur à travers cette procédure est d’éviter une liquidation immédiate, en offrant aux dirigeants un cadre juridique pour rebondir.
Comment ça se passe quand une entreprise est en redressement judiciaire ?
Une fois le jugement d’ouverture prononcé, la société poursuit son activité mais les décisions les plus importantes doivent être validées par l’administrateur judiciaire ou par le juge-commissaire.
Durant cette phase :
- les poursuites individuelles sont suspendues ;
- les dettes antérieures sont gelées ;
- les créanciers doivent effectuer une déclaration de créance dans un délai strict (généralement deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Quant au dirigeant, il reste souvent en poste mais sous contrôle. Il conserve certaines prérogatives, notamment sur les actes de gestion courante. Cependant, les décisions relatives au déroulement stratégique de l’entreprise ou les actes de disposition doivent être autorisées par le juge-commissaire.
Si des sommes suffisantes sont générées pendant l’exploitation, l’entreprise pourra envisager une clôture de la procédure de redressement ou un plan de redressement viable établi par l'administrateur. Celui-ci doit faire l'objet d'une validation des comités de créanciers et du tribunal, selon le statut législatif de la structure.
Comment engager une procédure de redressement judiciaire ?
L’ouverture d’une procédure collective de redressement ne peut intervenir que dans un cadre précis. Elle nécessite le respect de conditions de forme et de fond définies par le Code de commerce. Elle suppose aussi une analyse rigoureuse de la situation économique de l’entreprise.
Conditions d’éligibilité
Pour qu’une entreprise puisse entamer une procédure de redressement, elle doit se trouver dans une situation de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus régler son passif exigible avec son actif disponible.
Cette condition est au cœur du processus : c’est le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques ou tribunal judiciaire selon le cas) qui évalue la réalité de la situation économique. En effet, le bilan économique, les modalités de calcul de la trésorerie disponible, et l'état de la cessation sont soumis à une analyse approfondie, afin de statuer sur l'ouverture de la procédure.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours des derniers exercices permet d’évaluer la dimension de l’entreprise et son niveau de fragilité. C’est un indicateur clé dans l’analyse de l’état de la cessation des paiements.
Cette démarche judiciaire concerne l’ensemble des personnes visées à l’article L. 632-2 du Code de commerce : “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé." Ainsi, sont concernées par cette procédure :
- à la fois les sociétés commerciales (SARL, SAS), leur déclinaison unipersonnelle (EURL, SASU) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il en va de même des sociétés d'exercice libérale (SELARL, SELAS) ;
- les entrepreneurs individuels.
Les conditions de mise en œuvre d’une procédure de redressement reposent donc à la fois sur :
- l'existence d'une situation financière dégradée à savoir une société en état de cessation des paiements ;
- toute personne morale ou physique de droit privé entrant dans le champ de l'article L. 632-2 du Code de commerce et exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
La baisse significative du chiffre d'affaires constitue d’ailleurs souvent l’un des premiers signaux d’alerte. Elle peut, à elle seule, justifier l’ouverture d’une procédure collective de redressement lorsque les dettes ne peuvent plus être couvertes par les revenus générés.
Délai pour engager la procédure
Le débiteur en redressement judiciaire dispose de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements pour déposer une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal compétent. Ce délai est impératif, sous peine de voir la procédure se transformer en liquidation judiciaire si la situation est jugée irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ce délai peut également entraîner des sanctions à l'encontre du dirigeant de la société dès lors que l'état de cessation des paiements était manifeste et inévitable.
Qui peut faire la demande d'un redressement judiciaire ?
La procédure collective de redressement peut être déclenchée :
- par le débiteur lui même c'est à dire par l'entrepreneur individuel ou le représentant légal s'il s'agit d'une personne morale ;
- par un créancier disposant d’un titre individuel ou d’une qualité de créancier attestée ;
- par le ministère public lorsqu’un signalement est effectué (par exemple, via une alerte du greffe).
La demande se formalise par une requête déposée auprès du tribunal compétent, accompagnée d’un dossier complet comprenant plusieurs pièces justificatives. Parmi les documents généralement exigés, on retrouve notamment :
- un extrait Kbis récent ;
- les derniers comptes annuels ;
- une situation de trésorerie à jour ;
- un état détaillé du passif exigible et de l’actif disponible ;
- une liste des dettes et créances ;
- la liste des salariés de l’entreprise ;
- un inventaire du patrimoine et/ou des stocks ;
- et une attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des informations transmises.
Cette liste étant non exhaustive, le tribunal peut demander des documents complémentaires en fonction de la situation de l’entreprise.
Dans tous les cas, le tribunal reste le seul décisionnaire de l’ouverture de la procédure via un jugement d’ouverture, en se fondant sur les preuves apportées.
Suivez 18 actions de cette checklist et optimisez dès maintenant votre tréso !
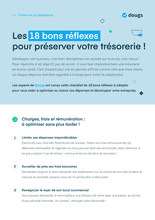
Déroulement de la procédure collective de redressement
Comme nous l’avons vu précédemment, pour initier la phase d’ouverture d’une procédure de redressement, une requête doit avoir été déposée au préalable par l’entreprise en état de cessation des paiements ou à l’initiative d’un créancier ou du Ministère public.
Le tribunal examine la requête, juge de l’état de cessation des paiements et analyse les chances de redressement. Si les chances de redressement sont sérieuses, alors le tribunal rend un jugement d’ouverture.
Ouverture de la procédure et jugement d’ouverture
Le jugement d’ouverture marque le point de départ officiel de la procédure. À compter de cette décision, la société entre dans une phase de gel de ses dettes et de suspension des poursuites engagées par les créanciers.
Ce jugement permet de :
- constater l’état de cessation des paiements et déterminer la date à laquelle elle est intervenue ;
- désigner les organes en charge de la procédure c’est à dire un ou plusieurs mandataires judiciaires, un juge-commissaire et, le cas échéant, sous conditions, un administrateur judiciaire ;
- fixer la date de commencement de la période d’observation, tout en y définissant sa longueur.
Dès la publication du jugement d'ouverture au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC), les créanciers disposent d’un délai de 2 à 4 mois selon les cas, pour transmettre leur déclaration de créance. L’ensemble des créanciers est informé via le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La période d’observation
La période d’observation est une phase stratégique. D’une durée de six mois renouvelable une fois,voire deux fois exceptionnellement à la demande du procureur de la République, soit pour une durée maximale de 18 mois en tout, elle permet :
- d’évaluer les chances de redressement de l’entreprise ;
- de dresser un état de la situation réel (économique, sociale, juridique) ;
- d’étudier la viabilité d’un plan de redressement.
Durant cette période, le débiteur en redressement continue son activité sous contrôle. Selon les cas, il peut gérer seul, ou sous autorisation, l'entreprise et réaliser les actes de gestion quotidienne nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Le dirigeant dans la gestion reste en fonction, mais ses décisions sont encadrées par les organes en charge de la procédure de redressement. L'objectif est d'établir les conditions de l’apurement du passif et de relancer, si possible, l’activité.
Intervenants clés de la procédure
Plusieurs acteurs assurent le bon déroulement de la procédure :
- le juge-commissaire : il surveille le bon déroulement du redressement, autorise certains actes et tranche les litiges ;
- le mandataire judiciaire : il représente les intérêts des créanciers et traite les déclarations de créance ;
- l’administrateur judiciaire (si nommé) : il peut soit assister, soit remplacer le dirigeant dans la gestion ;
- le représentant des salariés : désigné par le comité social, il veille à la défense des droits des employés ;
- les comités de créanciers : dans certaines entreprises, ils donnent leur avis sur le plan envisagé et peuvent influencer les décisions stratégiques.
Cette organisation vise à équilibrer les intérêts du débiteur en redressement, des salariés et des créanciers tout au long de la procédure.
Quels sont les effets de la procédure collective de redressement ?
La procédure collective de redressement a un impact considérable sur la vie de l’entreprise. Elle modifie en profondeur sa gouvernance, ses obligations financières, ses relations avec les créanciers et la gestion des salariés.
Les effets engendrés par la procédure collective de redressement sont encadrés par le droit français. Ils peuvent varier en fonction du statut législatif de l'entreprise concernée.
Effets sur la gestion de l’entreprise
Dès l’ouverture de la procédure, le dirigeant de la société est soumis à un contrôle renforcé. Il peut continuer à gérer l’entreprise, mais les actes de disposition sont soumis à autorisation du juge-commissaire ou à l’assistance d’un administrateur judiciaire, selon les cas.
Cela signifie :
- plus de liberté totale dans la prise de décisions majeures ;
- nécessité d’un accord pour des opérations sensibles : cession d’actifs, licenciements économiques, investissements…
Le traitement de sortie (ou la résolution finale de la procédure) dépendra en grande partie des efforts de restructuration menés durant cette phase. Il est donc crucial que le dirigeant dans la gestion coopère pleinement avec les organes désignés.
Les décisions relatives au déroulement de l’activité sont prises dans une logique de sauvegarde, tout en visant un objectif de redressement conforme à l’intérêt social.
Conséquences pour les salariés
Les contrats de travail ne sont pas automatiquement rompus à l’ouverture d’une procédure collective de redressement. Le maintien de l’emploi est une préoccupation centrale de cette procédure. Toutefois, des mesures de licenciement peuvent être prises si la société en difficulté ne parvient toujours pas à assainir sa situation financière.
En cas de licenciement économique :
- le plan doit être validé par le juge-commissaire ;
- les salariés licenciés bénéficient de la garantie des salaires via l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) ;
- le comité social et le représentant des salariés sont impliqués dans la procédure.
Le bilan économique présenté en période d’observation inclura donc systématiquement un volet social analysant les modalités de calcul des suppressions de postes envisagées.
Traitement des dettes et des créanciers
Pendant le redressement, les dettes antérieures à la procédure sont « gelées ». Le cours des intérêts est arrêté, et les créanciers doivent se faire connaître par une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois suivant la publication au BODACC.
Cette suspension du cours des intérêts permet de figer la dette et de faciliter la construction du plan de redressement, en évitant l’aggravation du passif pendant la période d’observation.
Les dettes sont ensuite regroupées et analysées en vue d’un apurement du passif. Le plan de redressement, s’il est adopté, fixe des conditions précises, à savoir :
- le délai de remboursement ;
- les réductions ou remises de dettes ;
- l'ordre de priorité selon la qualité de créancier.
Dans certains cas, des comités de créanciers sont constitués, notamment dans les grandes entreprises, pour valider ou non les propositions faites par le débiteur en redressement.
Les paiements sont-ils suspendus pendant la période de redressement ?
Pendant la période d’observation, l’entreprise doit continuer à régler ses dépenses courantes pour pouvoir poursuivre son activité, c'est-à-dire :
- les salaires en cours,
- les charges sociales,
- les fournisseurs postérieurs au jugement ;
- Les impôts dûs.
Ces paiements sont effectués à partir des sommes suffisantes générées par l’exploitation. En cas d’incapacité à faire face à ces charges, le tribunal peut mettre fin à la procédure et ordonner la liquidation judiciaire.
C’est l’entreprise elle-même qui finance cette phase, dans un cadre strictement contrôlé par les administrateurs judiciaires.
Comme il a été dit plus haut, le dirigeant continue à assumer son rôle, mais sous encadrement.
Quelles sont les issues possibles à la fin du redressement judiciaire ?
La procédure de redressement judiciaire ne peut durer indéfiniment. À l’issue de la période d’observation, le tribunal de commerce statue sur l’avenir de l’entreprise en fonction des éléments financiers, sociaux et opérationnels présentés.
Outre le cas où le tribunal prononce la clôture de la procédure en cas de paiement intégral des créanciers au cours de la procédure, deux autres voies s'offrent à l'entreprise : l'adoption d'un plan de redressement ou, en cas d'échec, la conversion en liquidation judiciaire.
Adoption d’un plan de redressement
Si l’activité est viable, le débiteur en redressement peut se voir proposer un plan de redressement. Ce plan, validé par le tribunal, vise à :
- rééchelonner les dettes ;
- restructurer l’activité ;
- maintenir le maximum d’emplois ;
- céder tout ou partie de l'entreprise à un tiers le cas échéant
Le plan peut durer jusqu’à 10 ans (voire 15 ans pour les activités agricoles). Il comprend :
- des engagements de paiement ;
- des cessions d’actifs non stratégiques ;
- des restructurations internes validées par les comités de créanciers.
Le tribunal vérifie la faisabilité économique du plan. Dans le cas échéant, il peut consulter le ministère public. La validation se fait par la suite par décision de justice, en prenant en compte l’intérêt des salariés, des créanciers, et la pérennité de l’activité.
Le respect des engagements est ensuite suivi par le mandataire judiciaire et les créanciers eux-mêmes, dans le cadre du statut législatif de la société.
Passage en liquidation judiciaire
Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire :
- si le bilan économique de l’entreprise est trop lourd ;
- si l'entreprise ne dispose pas des sommes suffisantes pour couvrir les dépenses courantes ;
- si aucun plan de redressement crédible ne peut être mis en œuvre.
Le passage en liquidation judiciaire implique :
- la cessation immédiate de l’activité ou sa cession ;
- la vente des actifs pour rembourser partiellement les créanciers ;
- la rupture des contrats de travail avec versement des indemnités via la garantie AGS ;
- l’éventuelle mise en cause du dirigeant en cas de faute de gestion manifeste.
Le dirigeant de la société peut, dans certains cas, être tenu personnellement responsable de l’insuffisance d’actifs. Il peut aussi être frappé d’une interdiction de gérer.
Cette décision de résolution est prononcée lorsque le traitement de sortie par redressement est jugé impossible.
Quelles alternatives au redressement judiciaire ?
Avant d’envisager un redressement judiciaire, il est souvent possible d’explorer d’autres solutions moins contraignantes pour une société en difficulté. Ces alternatives, prévues par le droit français, visent à traiter les problèmes en amont de la cessation des paiements, dans un cadre plus souple et souvent confidentiel. Elles permettent à l’entreprise de garder le contrôle tout en négociant des solutions viables avec ses créanciers.
La procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde s’adresse aux entreprises qui ne sont pas encore en cessation de paiement, mais qui rencontrent des difficultés sérieuses susceptibles d’y mener. Prévue par les articles L.620-1 et suivants du Code de commerce, elle permet d’anticiper la crise avant qu’il ne soit trop tard.
Contrairement au redressement judiciaire :
- elle ne nécessite pas l’état du passif exigible ;
- elle est entièrement à l’initiative du débiteur à la diligence ;
- elle permet la mise en place d’un plan de sauvegarde sans passer par une liquidation judiciaire en cas d’échec.
L’objectif de cette procédure est de préserver les chances de maintien de l’emploi et de traitement des dettes, tout en laissant une plus grande marge de manœuvre au dirigeant de la société.
Conciliation et mandat ad hoc
La conciliation et le mandat ad hoc sont des procédures confidentielles et extrajudiciaires permettant au chef d’entreprise d’obtenir l’aide d’un professionnel, pour négocier à l’amiable avec ses partenaires économiques.
Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle qui n’est pas conditionnée par la situation financière de l’entreprise. Il consiste en la désignation, par le tribunal, d’un mandataire ad hoc à la demande du dirigeant ou de la personne concernée. La durée de cette mission est libre. L'ensemble du processus se déroule en dehors de toute publicité, dans un cadre strictement confidentiel.
La conciliation, quant à elle, s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés sérieuses mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Le tribunal de commerce nomme un conciliateur, dont le rôle est d’accompagner le chef d’entreprise dans la négociation avec ses créanciers. Cette procédure peut, le cas échéant, aboutir à un accord amiable homologué par le juge, renforçant ainsi sa portée juridique.
Ces dispositifs sont parfois appelés titres de secours, car ils permettent de stabiliser une entreprise avant qu’un jugement d’ouverture ne s’impose.
Conséquences fiscales et sociales du redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire ne se limite pas aux seules conséquences économiques et organisationnelles. Elle entraîne également des répercussions sur le plan fiscal et social, que le dirigeant de la société doit impérativement anticiper. Ces effets varient selon la nature de la structure (SARL, SAS, entrepreneur individuel…), tout en étant encadrés par les règles du droit français.
Impact fiscal : gel des dettes, mais obligations maintenues
Une fois le jugement d’ouverture prononcé, les dettes fiscales contractées avant la procédure sont gelées comme l’ensemble du passif exigible. Cela signifie que l’entreprise n’est pas tenue de les régler immédiatement. Elles seront traitées dans le cadre du plan de redressement, selon des modalités de calcul spécifiques.
En revanche, l’entreprise reste tenue de :
- déclarer et régler la TVA, la CFE, et l’impôt sur les sociétés dus pendant la procédure ;
- maintenir une comptabilité claire et à jour ;
- fournir les justificatifs nécessaires aux administrateurs judiciaires ou au juge-commissaire.
En cas de manquement, le ministère public peut engager la responsabilité du dirigeant sur le terrain de la faute de gestion, notamment si des fraudes fiscales sont constatées ou si les déclarations sont omises.
Conséquences sociales : maintien des droits et cadre protecteur
Sur le plan social, les obligations de l’employeur restent en vigueur. Les contrats de travail des salariés sont maintenus, sauf décision de rupture validée par le juge-commissaire.
L’entreprise doit donc continuer à :
- payer les cotisations sociales dues à l’URSSAF et aux caisses de retraite ;
- fournir les fiches de paie ;
- respecter les droits collectifs des salariés (consultation du comité social, information du représentant des salariés, etc.).
En cas d’impossibilité de paiement des salaires, la garantie des salaires (AGS) prend le relais. Ce titre de secours permet de protéger les employés dans un contexte de crise financière.
Si une liquidation judiciaire survient, l’AGS prendra également en charge les indemnités légales liées à la rupture des contrats.
FAQ sur le redressement judiciaire
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre redressement et liquidation judiciaire ?
Est-il possible d’éviter une procédure de redressement judiciaire ?
Quel est le coût d’un redressement judiciaire d'une société ?
Comment savoir si une entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire ?

Maha est directrice des opérations. Chez Dougs, elle pilote le pôle formation des comptables et assure la coordination des opérations entre les différents services, garantissant une fluidité et une efficacité optimale.
En savoir plus


