Quelles clauses prévoir sur un contrat de commission ?
Plateforme agréée 100% gratuite
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement d’un contrat de commission et ses implications juridiques ?contrat de commission et ses implications juridiques ? Ce type de contrat permet à un intermédiaire d’agir en son propre nom, mais pour le compte d’un tiers, dans des secteurs comme le commerce, le transport ou l’affiliation. Comment fonctionne un contrat de commission ? Quelles sont les obligations des parties ? Quelles clauses essentielles doivent être incluses ?


- Un contrat de commission permet à un intermédiaire d'agir en son propre nom pour le compte d'un tiers, couramment utilisé dans le commerce, le transport et les services.
- Le commissionnaire a des obligations de diligence et de loyauté, tout en engageant sa responsabilité personnelle envers les tiers.
- Les clauses essentielles incluent la définition de la mission, la rémunération, la durée, et des clauses spécifiques comme le ducroire et la non-concurrence.
Je rentre dans le détail de chacun de ces points ci-dessous. Bonne lecture !
Commission et commissionnaire – définition et cadre légal
Définition du commissionnaire : quel est son rôle ?
Le commissionnaire est une personne qui agit en son propre nom ou sous une dénomination sociale pour le compte d'un commettant. À la différence du mandataire, le commissionnaire est personnellement engagé vis-à-vis des tiers avec lesquels il contractualise, sans dévoiler l'identité du commettant.
Le commissionnaire se distingue de deux autres types d’intermédiaires :
- agent commercial : en tant que mandataire indépendant, l'agent commercial a pour mission de négocier et de conclure des contrats au nom et pour le compte d'un mandant, dont l'identité est connue des tiers.
- courtier : le courtier se limite à établir un lien entre deux parties en vue de la conclusion d'un contrat, sans être partie prenante à ce contrat et sans en assumer les obligations qui en découlent.
Les différents types de contrats de commission
- Commerce : les commissionnaires facilitent les transactions en achetant ou en vendant des marchandises en leur propre nom pour le compte de leurs clients.
- Transport : les commissionnaires de transport organisent et réalisent le transport de marchandises, en prenant en charge la responsabilité de l'opération logistique.
- Services : dans le domaine des services, les commissionnaires peuvent intervenir pour négocier et conclure des contrats spécifiques au nom de leurs commettants.
Contrat de commission et Code civil : quelle réglementation s’applique ?
Le contrat de com mission est principalement encadré par le Code de commerce, en particulier l'article L132-1, qui définit le rôle du commissionnaire et précise ses obligations. Néanmoins, certaines dispositions du Code civil peuvent également être pertinentes, notamment en ce qui concerne la responsabilité contractuelle et l'exécution des engagements. La jurisprudence est venue également préciser certains aspects en l'absence de dispositions légales précises, notamment concernant la responsabilité du commissionnaire.
Les obligations et responsabilités des parties dans un contrat de commission sont établies par les textes législatifs en vigueur ainsi que par les clauses spécifiques du contrat. Le commissionnaire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec soin et loyauté, tandis que le commettant est tenu de fournir les informations nécessaires et de rémunérer le commissionnaire selon les termes convenus.

Catégories de contrat de commission
Contrat de commission à la vente : comment fonctionne-t-il ?
Le contrat de commission à la vente est fréquemment utilisé dans les relations B2B (Business to Business) et B2C (Business to Consumer). Dans ce cadre, le commissionnaire procède à la vente de produits ou de services en son propre nom, mais pour le compte d'un commettant. Ce modèle permet au commettant d'étendre sa portée commerciale sans assumer directement la responsabilité vis-à-vis des tiers.
Les conditions essentielles de ce type de contrat comprennent :
- définition précise de la mission : nature des produits ou services à commercialiser, objectifs commerciaux ;
- rémunération du commissionnaire : généralement sous forme d'une commission proportionnelle aux ventes effectuées ;
- durée du contrat : déterminée ou indéterminée, avec des clauses de résiliation ;
- obligations des parties : respect des engagements, confidentialité, etc.
Ces éléments garantissent une collaboration efficace entre le commissionnaire et le commettant.
Le commissionnaire se distingue de deux autres types d’intermédiaires :
L'apporteur d'affaires
L’apporteur d'affaires agit comme un simple intermédiaire, en mettant en relation une entreprise avec des clients potentiels. Contrairement au commissionnaire, il n’opère pas en son nom propre et n’est pas impliqué dans l’exécution du contrat entre les deux parties. Il n’endosse aucun risque lié à la transaction finale.
Sa rémunération est généralement définie dans un contrat spécifique, sous forme de :
- commission (un pourcentage sur l’affaire conclue grâce à son intervention) ;
- ou forfait (un montant fixe convenu à l’avance).
Les conditions de paiement, délais et autres modalités sont précisées dans le contrat pour garantir la transparence.
Le mandataire
Le mandataire agit au nom et pour le compte de son client (le mandant). Contrairement au commissionnaire, qui agit en son propre nom, le mandataire engage directement le mandant vis-à-vis des tiers.
Il intervient dans la négociation et/ou l’exécution du contrat, selon les pouvoirs qui lui sont confiés. Sa rémunération est également définie contractuellement, souvent sous forme de commission ou d’honoraires.
Contrat de commission en affiliation : un modèle hybride
Le contrat de commission en affiliation représente un modèle hybride qui intègre des éléments du contrat de commission et de l'affiliation marketing. Dans ce cadre, un affilié (commissionnaire) fait la promotion des produits ou services d'un annonceur (commettant) à travers ses propres canaux (sites web, réseaux sociaux, etc.). L'affilié agit en son propre nom pour le compte de l'annonceur, ce qui le différencie de l'apporteur d'affaires.
Ce modèle est particulièrement courant dans le dropshipping et l'e-commerce, où l'affilié :
- fait la promotion de produits : via des liens ou des bannières sur son site ;
- perçoit une commission : sur chaque vente réalisée grâce à son intervention.
Cette approche permet aux entreprises d'élargir leur réseau de vente sans avoir à gérer directement la relation avec le client final.
Travail à la commission : différents statuts, différentes implications
Il existe plusieurs formes de contrats dans lesquels la rémunération à la commission intervient, mais tous ne relèvent pas du statut de commissionnaire. Il est donc important de distinguer :
1. Le commissionnaire indépendant
Le commissionnaire agit en son nom propre, mais pour le compte d’un tiers. Il n’est pas salarié et ne dépend pas d’un lien de subordination. Sa rémunération prend généralement la forme d’une commission proportionnelle au chiffre d'affaires généré. Il engage sa responsabilité dans l’exécution du contrat, ce qui le distingue d’un apporteur d’affaires.
2. L’employé à la commission (salarié)
Un salarié peut être rémunéré partiellement ou entièrement à la commission, tout en étant lié par un contrat de travail. Il bénéficie alors de tous les droits associés à son statut :
Protection sociale (Sécurité sociale, retraite, assurance chômage)
Imposition sur le revenu salarial, avec prélèvement à la source
Droit du travail (congés payés, formation, etc.)
La commission est alors considérée comme un complément de rémunération et non un contrat commercial.
3. Les autres formes de collaboration commerciale
D’autres statuts peuvent prêter à confusion avec la notion de commission, comme :
Les agents commerciaux, qui représentent légalement une entreprise sans agir en leur nom propre.
Les apporteurs d’affaires, qui se limitent à la mise en relation sans responsabilité sur le résultat.
Les freelances avec rémunération variable, selon des performances ou résultats, sans être pour autant des commissionnaires au sens juridique.
Pourquoi bien identifier le statut ?
Chaque statut entraîne des implications juridiques, fiscales et sociales différentes. Il est donc primordial de bien définir la nature de la relation contractuelle dès le départ, pour éviter toute requalification
Contrat de commission de transport : quelles obligations ?
Le commissionnaire de transport organise, en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d'un commettant. Il est chargé de la logistique, du choix des transporteurs et des formalités douanières, garantissant ainsi une prestation complète.
Le contrat de commission de transport précise généralement :
- les obligations du commissionnaire : diligence, respect des délais, choix approprié des sous-traitants ;
- les responsabilités : en cas de perte, avarie ou retard, selon les termes convenus.
Ce contrat est régi par le Code des transports et le Code de commerce, notamment les articles L132-1 et suivants du code de commerce, qui définissent les obligations et responsabilités des commissionnaires.
Suivez 18 actions de cette checklist et optimisez dès maintenant votre tréso !
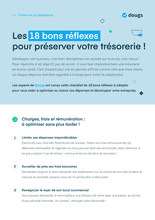
Obligations et responsabilités des parties
Quelles sont les obligations du commissionnaire ?
Le commissionnaire est chargé de réaliser la mission qui lui est confiée par le commettant, en respectant rigoureusement les instructions fournies. Il doit faire preuve de diligence et de loyauté, en accord avec les pratiques commerciales et la nature des marchandises concernées. Cette obligation inclut également la confidentialité concernant l'identité du commettant vis-à-vis des tiers, sauf indication contraire.
En agissant en son propre nom, le commissionnaire engage sa responsabilité personnelle envers les tiers. Il est responsable de l'exécution correcte de l'opération et assume les risques financiers qui en découlent, notamment en cas de défaillance des cocontractants. Néanmoins, une clause de "ducroire" peut être incluse, permettant au commissionnaire de garantir la solvabilité des tiers envers le commettant.
Quelles obligations pour le commettant ?
Le commettant est tenu de rémunérer le commissionnaire selon les modalités stipulées dans le contrat, que ce soit par le biais d'une commission proportionnelle à la valeur de l'opération ou d'un montant forfaitaire. Cette rémunération est due selon les modalités prévues au contrat, en principe dès que le commissionnaire a accompli sa mission conformément aux instructions reçues.
Bien que le commissionnaire soit le contact direct des tiers, la responsabilité du commettant peut être engagée en cas de litige, notamment si le commissionnaire a agi selon les directives du commettant. Il est donc crucial pour le commettant de fournir des instructions claires et conformes à la législation en vigueur afin de minimiser les risques juridiques.
Rédaction et clauses essentielles du contrat
Comment rédiger un contrat de commission ?
L'élaboration d'un contrat de commission nécessite une attention particulière aux éléments suivants :
- identification des parties : il est crucial de mentionner les noms, adresses et statuts juridiques du commettant ainsi que du commissionnaire ;
- objet du contrat : il convient de définir avec précision la nature de l'opération commerciale concernée, qu'il s'agisse de vente, d'achat ou de fourniture de services ;
- durée du contrat : il est important d'indiquer si le contrat est établi pour une période déterminée ou indéterminée, ainsi que les conditions de renouvellement ou de résiliation.
La clause relative à la rémunération du commissionnaire doit inclure les éléments suivants :
- assiette de la commission : préciser si la commission est calculée sur le chiffre d'affaires, le bénéfice ou un autre indicateur pertinent ;
- taux ou montant de la commission : indiquer le pourcentage appliqué ou le montant fixe convenu ;
- modalités de paiement : définir les délais et les conditions de versement de la commission.
Clauses spécifiques à inclure
Cette disposition, souvent désignée sous le nom de clause de ducroire, engage le commissionnaire à assurer au commettant la bonne exécution des obligations par les tiers contractants. En cas de manquement de la part de ces derniers, le commissionnaire prend en charge la responsabilité financière des pertes potentielles.
La clause de non-concurrence interdit au commissionnaire de mener des activités similaires qui pourraient nuire au commettant, tant pendant la durée du contrat qu'après. Pour être considérée valide en droit français, cette clause doit respecter les critères suivants :
- justification par des intérêts légitimes de l'entreprise : la clause doit viser à protéger un intérêt réel de l'entreprise ;
- limitation temporelle et géographique : la clause doit être raisonnablement restreinte en termes de durée et de zone géographique ;
- compensation financière : une indemnité doit être prévue pour le commissionnaire en raison de la restriction imposée ;
- prise en compte des spécificités de l'emploi : la clause doit tenir compte de la nature des fonctions exercées et permettre au commissionnaire de retrouver un emploi en adéquation avec ses compétences.
Il est crucial de rédiger ces clauses avec soin afin d'assurer leur validité juridique et d'éviter d'éventuels conflits.
Régime fiscal du commissionnaire indépendant
Commissionnaire indépendant :
- imposition des revenus : les revenus perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ;
- cotisations sociales : calculées sur le revenu d'activité indépendante retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, correspondant au bénéfice net imposable (chiffre d'affaires diminué des charges).
Il est important de noter que le commissionnaire indépendant ne bénéficie pas des mêmes protections sociales que le salarié, notamment en matière d'assurance chômage et de retraite.
FAQ sur le contrat de commission
- Définissez clairement le rôle du commissionnaire et du commettant, et leur responsabilité respective.
- Précisez la rémunération du commissionnaire, généralement sous forme de commission proportionnelle aux ventes.
- Incluez des clauses spécifiques comme celles de ducroire et de non-concurrence pour encadrer la relation.
- Assurez-vous que le contrat est conforme aux législations commerciales et civiles en vigueur.
Et si vous souhaitez sécuriser chaque étape de votre contrat de commission, n'hésitez pas à contacter les experts Dougs.
Questions fréquentes
C’est quoi un contrat de commission ?
Qu’est-ce qu’un contrat de paiement de commissions ?
Quelle est la différence entre un mandat et une commission ?
Quelles sont les obligations d’un commissionnaire ?
Quel est le fondement juridique du contrat de commission ?
Quelle est la différence entre un commissionnaire et un agent commissionné ?

Maha est directrice des opérations. Chez Dougs, elle pilote le pôle formation des comptables et assure la coordination des opérations entre les différents services, garantissant une fluidité et une efficacité optimale.
En savoir plus



