Dépôt de bilan SASU : guide complet
Plateforme agréée 100% gratuite
Gérer une SASU, c’est aussi faire face à des périodes de turbulence. Parmi les difficultés majeures qu’un dirigeant peut rencontrer, la cessation de paiements figure parmi les plus critiques. Lorsqu’une SASU ne parvient plus à régler ses dettes exigibles avec ses liquidités disponibles, elle entre dans un état juridique bien défini : la cessation de paiements. À partir de ce moment, le dépôt de bilan de la SASU devient une obligation légale pour le président de la sociét�é. Cette démarche, loin d’être purement administrative, marque une étape cruciale dans la vie de l’entreprise et peut aboutir à différentes issues, dont la plus redoutée est la liquidation judiciaire. Comprendre les tenants et aboutissants du dépôt de bilan est indispensable pour tout président de SASU confronté à une situation financière critique.


- Gérer une SASU implique de comprendre le processus de dépôt de bilan en cas de cessation de paiements, une obligation légale en cas de dettes impayées.
- Le dépôt de bilan est une déclaration officielle qui diffère de la liquidation judiciaire, cette dernière entraînant la cessation d'activité.
- Le président de la SASU doit suivre de près les finances pour éviter des conséquences personnelles et savoir remplir le formulaire Cerfa 10530*02 avec précision.
Je rentre dans le détail de chacun de ces points ci-dessous. Bonne lecture !
Définition : c'est quoi le dépôt de bilan et l'état de cessation de paiement pour une SASU ?
Dans le contexte d’une SASU, le dépôt de bilan correspond à une déclaration officielle effectuée par le président, unique représentant légal, auprès du tribunal de commerce. Par cette déclaration, il reconnaît que la société est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus régler ses dettes arrivées à échéance avec ses ressources financières immédiatement disponibles.
Il ne s’agit pas simplement d’une mesure comptable : c’est une démarche juridique impérative. Le président de la SASU doit l’effectuer dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de cessation de paiements, sauf si une procédure de conciliation a été engagée dans cet intervalle. Le non-respect de ce délai peut entraîner de lourdes conséquences personnelles pour le dirigeant, y compris sur le plan de sa responsabilité financière.
Quelle est la différence entre dépôt de bilan et liquidation judiciaire dans une SASU ?
Beaucoup de dirigeants confondent encore ces deux notions, qui relèvent pourtant de logiques très différentes.
Le dépôt de bilan n’est pas une condamnation. Il s’agit d’une obligation légale de déclaration : le président reconnaît que la société est en difficulté financière, et sollicite l’ouverture d’une procédure collective. Ce dépôt peut mener à plusieurs types de procédures, dont le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, mais il ne signifie pas automatiquement que l’activité cessera.
En revanche, la liquidation judiciaire constitue une mesure prononcée par le tribunal lorsque la SASU est en cessation de paiements et qu’aucun redressement n’est envisageable. Dans ce cas, la société est dissoute, son activité cesse, ses biens sont vendus pour désintéresser les créanciers, et un liquidateur judiciaire est nommé pour gérer les opérations.
Ne pas confondre dépôt de bilan et cessation d’activité : deux démarches bien distinctes en SASU
Lorsqu’un dirigeant de SASU est confronté à des difficultés ou à un changement de cap, il est essentiel de distinguer deux notions souvent confondues : le dépôt de bilan et la cessation d’activité. Ces deux événements n'ont ni les mêmes causes, ni les mêmes conséquences juridiques.
Le dépôt de bilan, ou déclaration de cessation des paiements, intervient lorsque la SASU n’est plus en mesure de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible. Cette situation traduit un état d’insolvabilité, qui impose au président de saisir le tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
À l’inverse, la cessation d’activité désigne la fermeture (volontaire ou involontaire) définitive de la société, indépendamment de son état financier. Cette décision peut être motivée par de nombreuses raisons : la fin de l’objet social, l’arrivée au terme fixé dans les statuts, une volonté personnelle du président, ou encore un accord de dissolution de la SASU pris par l’associé unique. Il s’agit alors d’un choix de mettre fin à la société, soit de manière amiable, soit dans certains cas via une décision judiciaire.
Le rôle central du passif exigible dans la cessation de paiements d'une entreprise
Le passif exigible représente l’ensemble des dettes qui arrivent à échéance et que la société doit régler immédiatement. Il peut s’agir de loyers impayés, de dettes fiscales, de charges sociales ou de factures fournisseurs. Ce passif est comparé à l’actif disponible, c’est-à-dire aux ressources que la SASU peut mobiliser immédiatement : solde bancaire, caisse, titres liquides…
Lorsque l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible, la société est en cessation de paiements. Il est alors impératif pour le président de déposer le bilan dans les délais légaux. S’il ne le fait pas, il peut engager sa responsabilité personnelle, notamment en cas de faute de gestion ou de manquement à ses obligations. Dans certains cas, il pourrait être condamné à combler le passif de la société sur ses propres deniers.
C’est pourquoi il est crucial pour le président d’une SASU de suivre de près la situation financière de la société, notamment les échéances de paiement, la trésorerie disponible, et de prendre des mesures correctrices dès l’apparition des premières difficultés.
Suivez 18 actions de cette checklist et optimisez dès maintenant votre tréso !
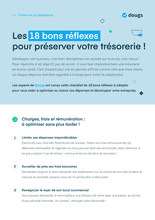
Comment déposer le bilan en SASU : les démarches à faire
Le dépôt de bilan d’une SASU doit être effectué auprès du tribunal de commerce du siège social. La procédure commence par le formulaire Cerfa n°10530*02, qui constitue la déclaration de cessation des paiements. Ce document, à remplir avec précision, doit être complété et accompagné de plusieurs pièces justificatives obligatoires, dont :
- un extrait Kbis de la SASU (datant de moins de trois mois) ;
- un état actif/passif détaillé, incluant les garanties et engagements hors bilan, datant de moins de sept jours ;
- une situation de trésorerie de moins de trois mois ;
- un état chiffré des créances et des dettes ;
- un inventaire sommaire des actifs de la société (matériel, immobilier, stocks, etc.) ;
- les comptes annuels du dernier exercice clos.
Le tout doit être déposé en quatre exemplaires au greffe du tribunal compétent. Une fois les documents reçus, le président est convoqué à une audience. Le juge décidera alors d’ouvrir la procédure la plus appropriée : redressement ou liquidation.
Déclaration de cessation des paiements : comment remplir le Cerfa 10530*02 ?
Le formulaire Cerfa 10530*02 est la pièce maîtresse du dossier. Il doit être complété soigneusement, car il retrace l’ensemble des éléments permettant d’évaluer la situation économique de la SASU.
Voici les principales informations qui doivent y figurer :
- l’identité de la SASU : dénomination sociale, numéro SIREN, adresse du siège ;
- la description de l’activité exercée ;
- les coordonnées du président de la SASU ;
- la date exacte de la cessation de paiements ;
- l’origine des difficultés rencontrées ;
- les chiffres clés : capital social, chiffre d’affaires, nombre de salariés (s’il y en a) ;
- le détail des dettes, notamment fiscales et sociales ;
- les perspectives de redressement ou les tentatives de conciliation antérieures.
Le formulaire, une fois complété, doit être accompagné des pièces justificatives listées plus haut. Le dépôt doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, sauf procédure de conciliation en cours.
La période suspecte : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-elle importante ?
Lorsqu’une SASU déclare sa cessation des paiements au tribunal de commerce, ce dernier est chargé de fixer la date effective à laquelle l’entreprise a cessé de pouvoir faire face à ses dettes exigibles. Cette date marque le point de départ d’une période particulière, appelée période suspecte.
La période suspecte correspond à l’intervalle de temps entre la date de cessation des paiements (retenue par le tribunal) et le jugement d’ouverture de la procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Elle ne peut pas excéder 18 mois.
Cette période n’est pas appelée « suspecte » par hasard. Elle vise à protéger l’intérêt collectif des créanciers en permettant au tribunal d’examiner, et le cas échéant, d’annuler certains actes juridiques ou financiers passés par l’entreprise durant cette phase.
Pourquoi encadrer cette période ?
L’objectif de la période suspecte est clair : éviter que le dirigeant n’organise sa propre insolvabilité ou ne privilégie certains créanciers au détriment des autres. Il s’agit donc d’un mécanisme de contrôle qui permet de remettre en cause certains actes jugés préjudiciables à l’égalité des créanciers ou à la préservation du patrimoine de l’entreprise.
Quels actes peuvent être annulés pendant la période suspecte ?
Certains actes réalisés par le président de la SASU durant cette période sont automatiquement considérés comme irréguliers et peuvent être annulés par le tribunal. Cela inclut notamment :
- le paiement d’une dette avant son échéance : par exemple, régler une facture à un fournisseur alors qu’elle n’était pas encore exigible ;
- la souscription d’un prêt alors que l’endettement de la société est déjà manifeste, ce qui aggrave la situation financière de la SASU ;
- le transfert d’un bien de la société sans contrepartie (donation déguisée) à un créancier ou à un tiers.
D'autres actes peuvent être annulés à la demande du mandataire judiciaire ou du ministère public, même s'ils ne figurent pas sur la liste des nullités de droit. Le tribunal apprécie alors si ces actes ont causé un déséquilibre entre les créanciers ou vidé l’actif de l’entreprise.
Une mesure de protection des créanciers
Cette mesure joue donc un rôle fondamental dans le cadre d’une procédure collective. Elle permet de rétablir une certaine équité entre les créanciers en annulant les actes qui auraient été effectués dans une logique de favoritisme ou de dissimulation.
Le président de la SASU doit donc faire preuve d’une grande prudence dans la gestion de sa société dès qu’une situation de cessation de paiements est envisageable, et éviter toute opération qui pourrait être remise en cause par le tribunal.
Combien coûte un dépôt de bilan pour une SASU ?
En soi, le dépôt de bilan n’entraîne aucun frais de greffe. Cependant, dans la pratique, le président d’une SASU fait souvent appel à un expert-comptable ou un avocat pour l’accompagner dans cette procédure complexe. Les honoraires varient selon la complexité du dossier, le volume des dettes et le niveau d’urgence de la situation.
Ces frais peuvent inclure :
- l’analyse de la situation financière ;
- la préparation des états financiers nécessaires ;
- la rédaction du formulaire Cerfa ;
- l’accompagnement devant le tribunal.
Même si cela représente un coût, un accompagnement professionnel peut éviter des erreurs lourdes de conséquences.
Les conséquences immédiates pour la SASU d'une cessation de paiement et d'un dépôt de bilan
Le sort des contrats en cours
L'ouverture de la procédure ne met pas automatiquement fin aux contrats existants de la SASU. Le mandataire judiciaire évalue chaque engagement pour décider de sa poursuite ou de sa résiliation.
Les contrats de travail restent actifs pendant une période transitoire, laissant au mandataire le temps d'organiser la suite des opérations. Cette phase permet d'éviter une rupture brutale de l'activité.
Les baux commerciaux bénéficient d'un statut particulier : leur maintien dépend des perspectives de continuation de l'activité. Le mandataire peut négocier avec le propriétaire des aménagements temporaires des conditions locatives.
Les engagements commerciaux comme les contrats fournisseurs font l'objet d'une analyse au cas par cas. Le mandataire privilégie la préservation des relations essentielles à une potentielle reprise d'activité.
La gestion des dettes bancaires et des prêts
Les prêts bancaires bénéficient d'un traitement particulier lors du dépôt de bilan. Le remboursement des échéances s'interrompt automatiquement dès la déclaration au tribunal, permettant un gel temporaire des dettes.
Un plan d'échelonnement peut être négocié avec les établissements bancaires sous la supervision du tribunal. Cette mesure concerne notamment les crédits professionnels et les découverts autorisés.
La responsabilité personnelle du président de SASU mérite une attention spéciale. S'il s'est porté caution pour garantir les emprunts de sa société, la banque conserve la possibilité de réclamer le remboursement sur son patrimoine personnel. Cette situation s'applique particulièrement aux prêts garantis par l'État (PGE) souscrits depuis 2020.
Quelles conséquences pour les salariés d’une SASU en dépôt de bilan ?
La SASU est par définition une société unipersonnelle, mais cela n’interdit pas l’embauche de salariés. Si des employés sont présents au moment du dépôt de bilan, ils sont directement concernés par la suite de la procédure.
En cas de liquidation judiciaire, des licenciements économiques sont souvent inévitables. Heureusement, les salariés bénéficient de garanties spécifiques via l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), qui prend en charge :
- les salaires impayés ;
- les indemnités de licenciement ;
- les congés payés dus.
En cas de redressement judiciaire, les contrats de travail sont maintenus, sauf autorisation du juge-commissaire. Si une cession d’activité est envisagée, les contrats peuvent être transférés à l’entreprise repreneuse.
Dans les SASU de plus de 50 salariés, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) peut être obligatoire en cas de licenciement collectif. Ce plan prévoit des mesures de reclassement et de soutien aux salariés concernés.
Combien de temps dure une liquidation judiciaire de SASU ?
La durée d’une liquidation judiciaire dépend de nombreux facteurs. Elle commence en général par une phase d’observation, d’une durée variable, durant laquelle le tribunal évalue si un redressement est envisageable.
Lorsque la liquidation est prononcée, la procédure peut durer :
- en moyenne 2 à 3 ans dans une liquidation classique ;
- 9 à 12 mois dans une liquidation judiciaire simplifiée (possible pour les SASU sans salariés et avec peu d’actifs).
La durée peut être prolongée si :
- le patrimoine est difficile à évaluer ou à vendre ;
- des créanciers contestent certaines créances ;
- de nouveaux éléments apparaissent pendant la procédure.
Peut-on créer une nouvelle entreprise après une liquidation judiciaire de SASU ?
Oui, un président de SASU peut tout à fait recréer une entreprise après une liquidation judiciaire, à condition qu’aucune interdiction de gérer n’ait été prononcée à son encontre. Cette possibilité reste ouverte même si la précédente SASU a connu une issue défavorable, tant que les règles ont été respectées.
En revanche, le futur projet devra tenir compte du contexte de la précédente liquidation, notamment en matière de gestion, de stratégie financière et de relations avec les créanciers.
- Le dépôt de bilan pour une SASU doit être effectué dans les 45 jours suivant la cessation de paiements, sauf en cas de conciliation.
- Préparez un dossier complet avec les états financiers et le formulaire Cerfa 10530*02 pour le tribunal de commerce.
- Soyez vigilant durant la période suspecte pour éviter des actes contestables par le tribunal.
- Envisagez un accompagnement d'experts pour éviter des erreurs coûteuses.
Et si vous souhaitez sécuriser chaque étape de cette démarche délicate, n'hésitez pas à contacter les experts Dougs pour un accompagnement personnalisé.

Entre deux sessions de conseil client, supervision de bilans comptables, management et formation de ses équipes, elle s’adonne à sa passion : la rédaction de contenus. Elle met sa plume et son expertise au service de sujets de fond sur la création d’entreprise et la comptabilité.
En savoir plus



