Société en nom propre : comment fonctionne cette structure ?
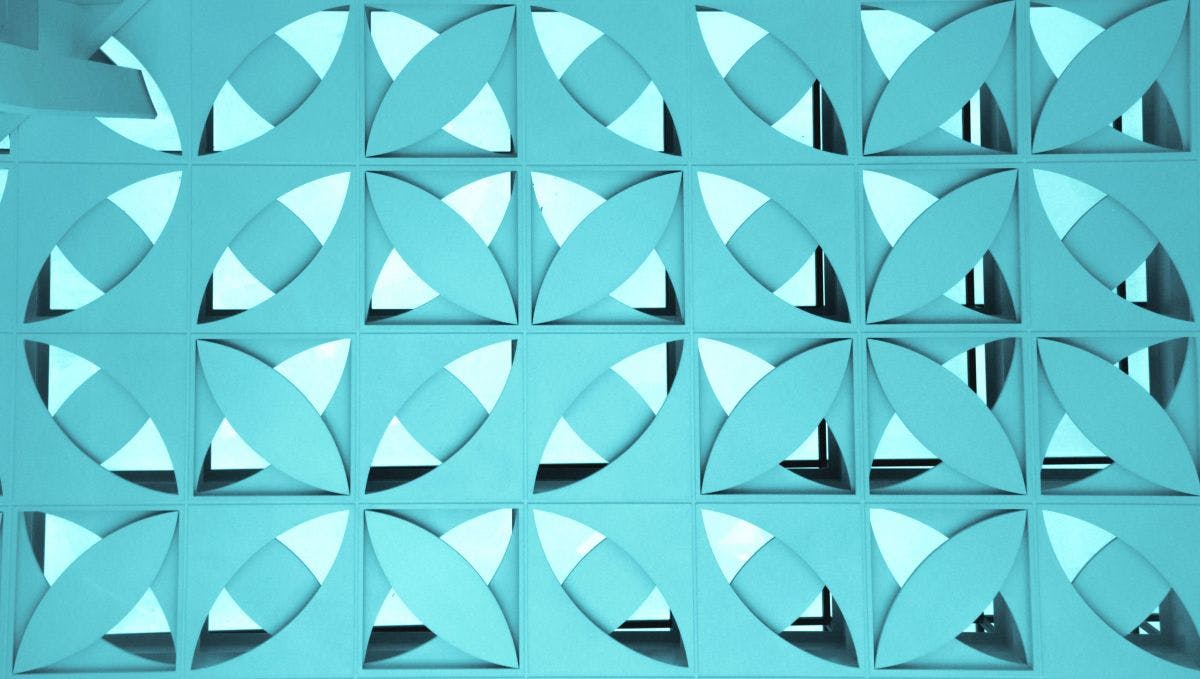
Vous vous posez la question de la forme juridique pour créer votre activité ? À cette occasion, un terme vous est sûrement devenu familier : société en nom propre. Toutefois, savez-vous précisément ce qu’il désigne ? Avez-vous déjà entendu l’expression “exercer en nom propre” ? Voyons ensemble ce que cette terminologie représente, quelles sont les particularités de l’exercice en nom propre, et ses modalités de fonctionnement, de la création à la dissolution.
Cet article reprend tout ce qu’il faut savoir pour réussir votre projet, que vous soyez chef d’entreprise, de profession libérale ou encore travailleur indépendant !
Définition : qu’est-ce qu’une société en nom propre ?
Sachez tout d’abord que le terme “société en nom propre” est plutôt inapproprié.
En effet, il ne s’agit pas d’une société à proprement parler puisque cette forme n’est pas dotée de la personnalité morale. En cas d’exercice en nom propre, l’entreprise n’existe qu’à travers son dirigeant qui l’exploite en son nom. Il assume seul l’entière responsabilité des opérations, ainsi que leurs conséquences.
Mais quelle est alors la différence entre la société en nom propre et l’entreprise individuelle (EI) ? Et bien…il n’y en a pas vraiment. L’exercice en nom propre renvoie la plupart du temps à l’entreprise individuelle.
Comment savoir si une entreprise est en nom propre ?
À quoi pouvez-vous identifier qu’un entrepreneur a choisi d’exercer son activité en nom propre ?
C’est très simple. Lorsque l’activité est réalisée en société, la forme juridique choisie est clairement mentionnée sur son extrait Kbis. Vous y verrez alors apparaître “société à responsabilité limitée” (SARL), “société par actions simplifiée” ‘(SAS), etc.
Autre indicateur : les documents émanant de l’entreprise, comme les factures, doivent reprendre obligatoirement la forme juridique de l’entité.
Besoin de vérifier ? Il vous suffit de saisir le numéro SIREN ou le nom du dirigeant sur le site infogreffe. Vous y retrouverez ces éléments.
Suivez 18 actions de cette checklist et optimisez dès maintenant votre tréso !
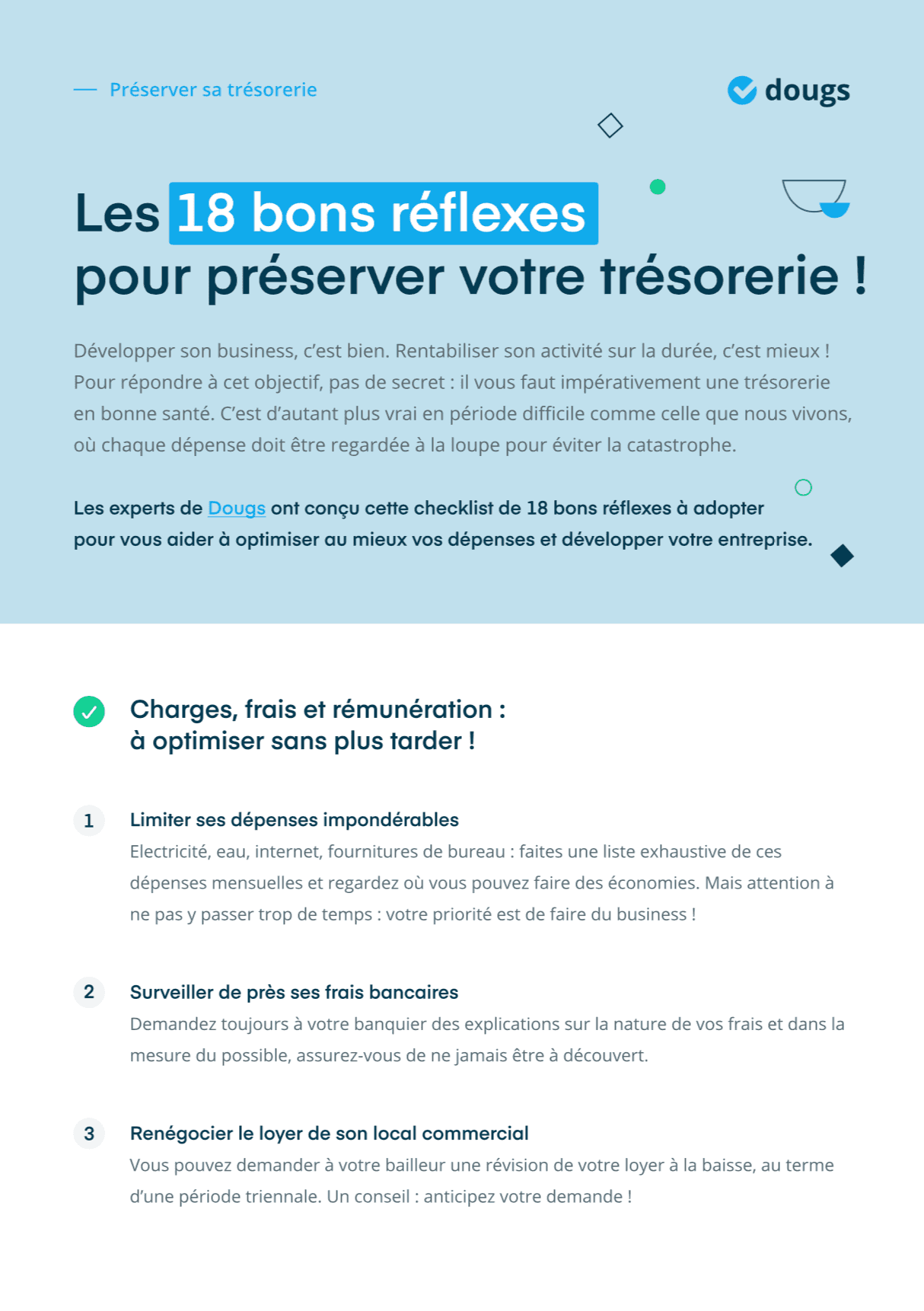
Les formes juridiques d’une société en nom propre : entreprise individuelle ou micro-entreprise ?
L’exercice en nom propre peut tout de même s’opérer sous différentes formes. Voici les principales :
L’entreprise individuelle (EI) : choix premier de la société en nom propre
L’EI est une forme d’exercice dans laquelle l’exploitant n’est pas réellement distinct de l’entreprise. Ceci, car il n’existe pas de personnalité morale de l’EI.
Toutes les opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation le sont donc au nom du chef d’entreprise.
C’est ainsi que sa responsabilité est illimitée : le patrimoine personnel du dirigeant peut alors être engagé en remboursement des dettes de l’entreprise. Ce principe sera atténué grâce au “Plan indépendants” à venir.
De même, l’imposition du bénéfice est réalisée à travers les mains de l’exploitant, sur son imposition personnelle. L’entreprise individuelle en nom propre ne paye donc pas son propre impôt.
Micro-entreprise : quelle différence entre auto-entrepreneur et entreprise individuelle ?
La micro-entreprise est gérée par un micro-entrepreneur. C’est en réalité une entreprise individuelle en nom propre dans laquelle les problématiques sociales et fiscales ont été considérablement simplifiées. Ce statut rend possible le paiement de l’impôt sur le bénéfice en retenant simplement un pourcentage du chiffre d’affaires (CA). Il en va de même pour le calcul des cotisations sociales que vous devez verser.
Tout comme l’EI, la micro-entreprise entraîne la responsabilité illimitée de l’exploitant micro-entrepreneur.
Cette forme ne vous est toutefois accessible qu’en deçà de certains seuils de chiffre d’affaires, variables selon la nature de votre activité. Ainsi, si votre chiffre d’affaires le dépasse, micro-entrepreneur, ce n’est tout simplement plus possible !
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) jusqu’en fin 2021
Pour l’EIRL – à responsabilité limitée -, si vous n’avez pas sauté sur l’occasion avant début 2022, c’est terminé ! Les anciennes EIRL continuent d’exister, mais il n’est plus possible d’en créer de nouvelles.
En effet, le “Plan Indépendants” a sonné le glas de l’EIRL. N’en soyez pas trop peiné car cette forme n’avait pas rencontré un franc succès.
On se dirige désormais vers un statut unique d’entreprise individuelle intégrant une relative protection du patrimoine de l’exploitant face aux créanciers. Et aussi une possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés. Textes à paraître !
Quels sont les principaux avantages d’une société en nom propre ?
Les avantages de l’exercice en nom propre tiennent surtout à sa simplicité et à la faiblesse des coûts engendrés.
- L’EI peut répondre aux besoins de tous, sans incapacité ou de limitations entravant son envie d’entreprendre, et souhaitant lancer seul et rapidement son affaire.
- Notez qu’il est extrêmement simple de créer une entreprise individuelle en nom propre. Il vous suffit de remplir quelques formulaires. Cela peut se faire sous format papier ou via Internet auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) compétent. On parle ici par exemple de l’Urssaf pour les titulaires de BNC ou bien de la chambre de métiers pour les artisans. Nous reviendrons sur ce point plus en détail par la suite.
- Aucun document complexe comme des statuts ou des annonces légales n’est requis. Les obligations comptables sont allégées.Cette apparente facilité recèle toutefois quelques pièges. Lors de la complétion de votre formulaire d’immatriculation, vous devrez notamment mentionner le régime de TVA retenu. Cela nécessite quelques connaissances pour éviter une option qui vous serait préjudiciable dans le futur.
- En outre, aucune approbation de comptes annuels n’est applicable aux entrepreneurs individuels. Vous n’avez donc pas à rédiger d’assemblées générales ordinaires ni à effectuer de dépôt des comptes auprès du greffe. Cela simplifie amplement votre gestion administrative.
👉 Bon à savoir : Si votre résidence principale est d’emblée protégée des créanciers de l’entreprise individuelle en nom propre, il n’en va pas de même pour les autres éléments composant votre patrimoine. Nous ne pouvons que vous conseiller d’envisager une déclaration d’insaisissabilité avec votre notaire dès la constitution.
- L’entreprise individuelle en nom propre présente l’avantage de générer de faibles coûts. Les frais de constitution sont très réduits (moins de 25 euros à verser au CFE). Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la rédaction de statuts qui auraient nécessité l’intervention de professionnels de la discipline contre facturation.
- Enfin, aucun capital n’est demandé. Cela signifie que vous pouvez débuter l’activité sans ne verser aucun euro. Un peu utopique toutefois, car vous aurez probablement à faire quelques avances sur vos deniers personnels pour financer les premiers achats nécessaires à votre exploitation (de l’outillage, de la publicité, un site web, du carburant, etc.).
- Au sujet des économies, petit avantage à souligner : si vous réalisez un déficit, celui-ci peut s’imputer sur le revenu global du foyer fiscal. Ainsi, vous pouvez économiser des impôts grâce à cette perte ! Pour voir le verre à moitié plein…
La fonction du dirigeant dans une entreprise individuelle en nom propre
Le dirigeant de l’entreprise individuelle en nom propre est obligatoirement une personne physique (donc… roulement de tambour… pas une personne morale !).
Dans l’exercice en nom propre, on ne parle ni de gérant, ni d’exploitant. Le terme le plus commun est celui de chef d’entreprise. Vous retrouvez également celui d’exploitant ou d’entrepreneur individuel. Si vous souhaitez être appelé Monsieur le Président dans l’intimité, songez à la SAS !
Le rôle du chef d’entreprise est évidemment de mener l’activité. C’est-à-dire de prendre toutes les décisions nécessaires à la réalisation de l’objet social : achat de matériels, investissements productifs, embauches …
Le régime d’imposition de la société en nom propre
Jusqu’à très récemment, le seul régime fiscal ouvert aux entreprises individuelles en nom propre était l’impôt sur le revenu (IR). Les bénéfices générés par l’exploitation étaient alors imposés dans différentes catégories, selon la nature de l’activité réalisée (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, etc.).
Une évolution récente bouscule ce principe : les entrepreneurs individuels devraient prochainement pouvoir choisir d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cependant, il faudra faire preuve de patience car les textes ne sont pas encore publiés !
Qu’en est-il de la TVA dans une entreprise individuelle en nom propre ?
Sur la question de la TVA, aucune différence entre l’entreprise individuelle en nom propre et les sociétés. C’est la nature de l’activité et son niveau (le CA) qui dicte ici les règles. L’entreprise individuelle en nom propre peut être assujettie ou non à la TVA, et peut relever d’un régime simplifié ou d’un régime réel.
Les modalités déclaratives sont exactement les mêmes, quelle que soit la forme juridique retenue. Il est toujours bon de préciser qu’existent quelques particularités existent en revanche pour les activités agricoles.
Pour en savoir plus sur la TVA de manière générale, nous vous invitons à lire cet article dédié à ce sujet !
Et la comptabilité pour une société en nom propre ?
Les obligations comptables qui s’appliquent à l’exercice en nom propre sont conditionnées par la nature de l’activité et par le régime d’imposition (régime réel ou régime simplifié).
Les entreprises au régime simplifié ont des obligations considérablement allégées. A contrario, celles au régime réel présentent des contraintes administratives plus lourdes.
Souvent, celles relevant des bénéfices non commerciaux peuvent s’appuyer sur une comptabilité de trésorerie. De manière schématique, on ne prend en compte que les opérations traduites par des débits ou des crédits sur le compte bancaire.
Quant à celles relevant des bénéfices industriels et commerciaux, on s’appuie souvent sur une comptabilité d’engagement, ou comptabilité en créances-dettes. Dans ce cas, l’ensemble des pièces comptables de l’exercice sont enregistrées, au régime réel.
Au régime simplifié, on pourra se contenter d’une tenue comptable en trésorerie sur tout l’exercice, avec l’obligation de reconstituer les créances et les dettes lors de la date de la clôture.
Dans tous les cas, certains registres et journaux doivent êtres tenus : livre-journal, grand livre, etc.
Comment créer et ouvrir une entreprise individuelle en nom propre ?
Comme nous en avons parlé précédemment, l’immatriculation d’une entreprise individuelle en nom propre est très simple et peu coûteuse.
Voici les frais à prévoir pour ce faire :
- L’immatriculation au RCS et le dépôt d’actes dans le cas d’une activité commerciale vous coûteront environ 24 € ;
- L’immatriculation au Répertoire des métiers (RM) dans le cas d’une activité artisanale vous coûtera 45 € supplémentaires si vous n’êtes pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Ce sera 15 € dans le cas contraire.
Pour ce qui est des formalités associées, sachez tout d’abord qu’il vous faut remplir un formulaire de création P0. Sachez qu’il en existe différents modèles selon la nature de votre activité.
Plusieurs documents doivent accompagner votre dépôt au centre de formalité des entreprises :
- Une copie de pièce d’identité ;
- Une justification de domiciliation ;
- Une déclaration de non condamnation ;
- En cas d’activité réglementée, un justificatif de l’autorisation délivrée ;
- Une copie de la déclaration d’insaisissabilité faite devant notaire, si nécessaire.
Une fois ceci réalisé, vous pouvez commencer à exploiter votre entreprise.
Société en nom propre : comment faire en cas d’arrêt d’activité ?
Tout ne s’est pas déroulé comme vous l’attendiez, ou vous avez tout simplement décidé de saisir d’autres opportunités ? Vous souhaitez donc réaliser la radiation de votre entreprise individuelle en nom propre du registre sur lequel elle est inscrite.
Les formalités sont nettement moins complexes que pour la liquidation d’une société.
Deux étapes essentielles sont à réaliser :
- Une radiation purement administrative en complétant un formulaire P4 ;
- Une radiation auprès de l’administration fiscale par la production d’une liasse fiscale dans les 45 jours suivant la radiation administrative.
Vous aurez alors à vous acquitter des soldes de TVA dus. Les éventuelles plus-values réalisées sur la cession des éléments de l’actif et les bénéfices placés en sursis d’imposition seront alors soumis à l’impôt. Les bénéfices réalisés sur l’exercice durant lequel vous cessez l’activité subissent ce même sort.
Votre entreprise individuelle en nom propre est alors fermée.
FAQ : pour aller plus loin sur la société en nom propre
Les sociétés en nom propre peuvent-elles avoir des salariés ?
Une entreprise individuelle en nom propre dispose des mêmes moyens que toute forme juridique pour développer son business. Vous pouvez donc parfaitement embaucher les salariés nécessaires à la croissance de votre affaire.
Qu’est ce que la responsabilité illimitée au juste ?
La responsabilité illimitée signifie que les biens personnels de l’entrepreneur peuvent être saisis par des créanciers pour solder les dettes. Elle est à opposer à la responsabilité limitée aux apports que l’on connaît dans les sociétés comme les SARL ou les SAS.
L’entrepreneur individuel peut-il exploiter l’activité avec son conjoint ?
Deux statuts sont ouverts au conjoint du chef d’entreprise : conjoint collaborateur et conjoint salarié.
Le conjoint salarié se trouve dans la même situation que tout salarié de la société (contrat de travail, rémunérations, cotisations sociales…).
Le conjoint collaborateur n’est pas rémunéré et dispose du droit de participer à la direction de l’entreprise.
Quel est le statut social de l’exploitant d’une société en nom propre ?
L’entrepreneur individuel relève de la sécurité sociale des indépendants. Il est considéré comme un travailleur non salarié.
Vous connaissez désormais les caractéristiques de l’exercice en nom propre d’une activité. Peut-être vous interrogez-vous sur l’exercice en société ? Nous vous avons préparé des articles vous permettant d’y voir plus clair.
Cependant, si vous avez besoin de conseils, notre équipe d’experts est là pour vous.

Entre deux sessions de conseil client, supervision de bilans comptables, management et formation de ses équipes, elle s’adonne à sa passion : la rédaction de contenus. Elle met sa plume et son expertise au service de sujets de fond sur la création d’entreprise et la comptabilité.
En savoir plus


