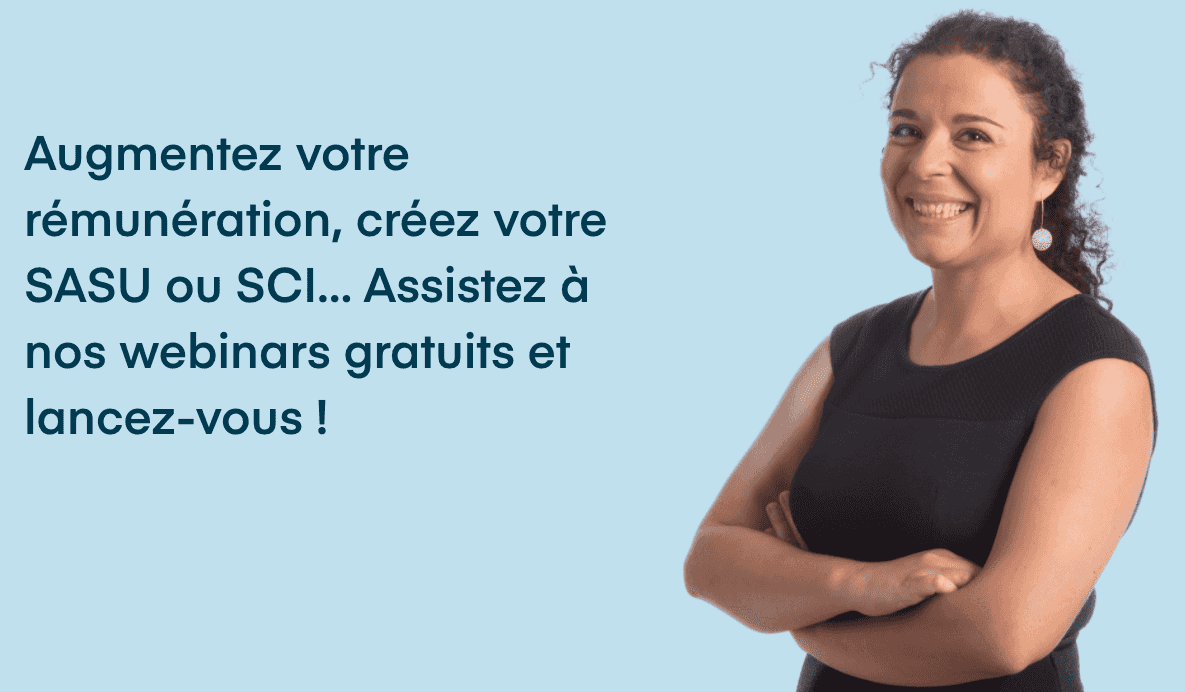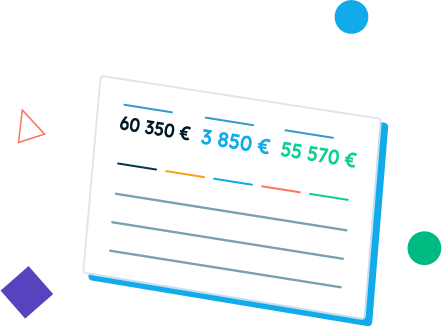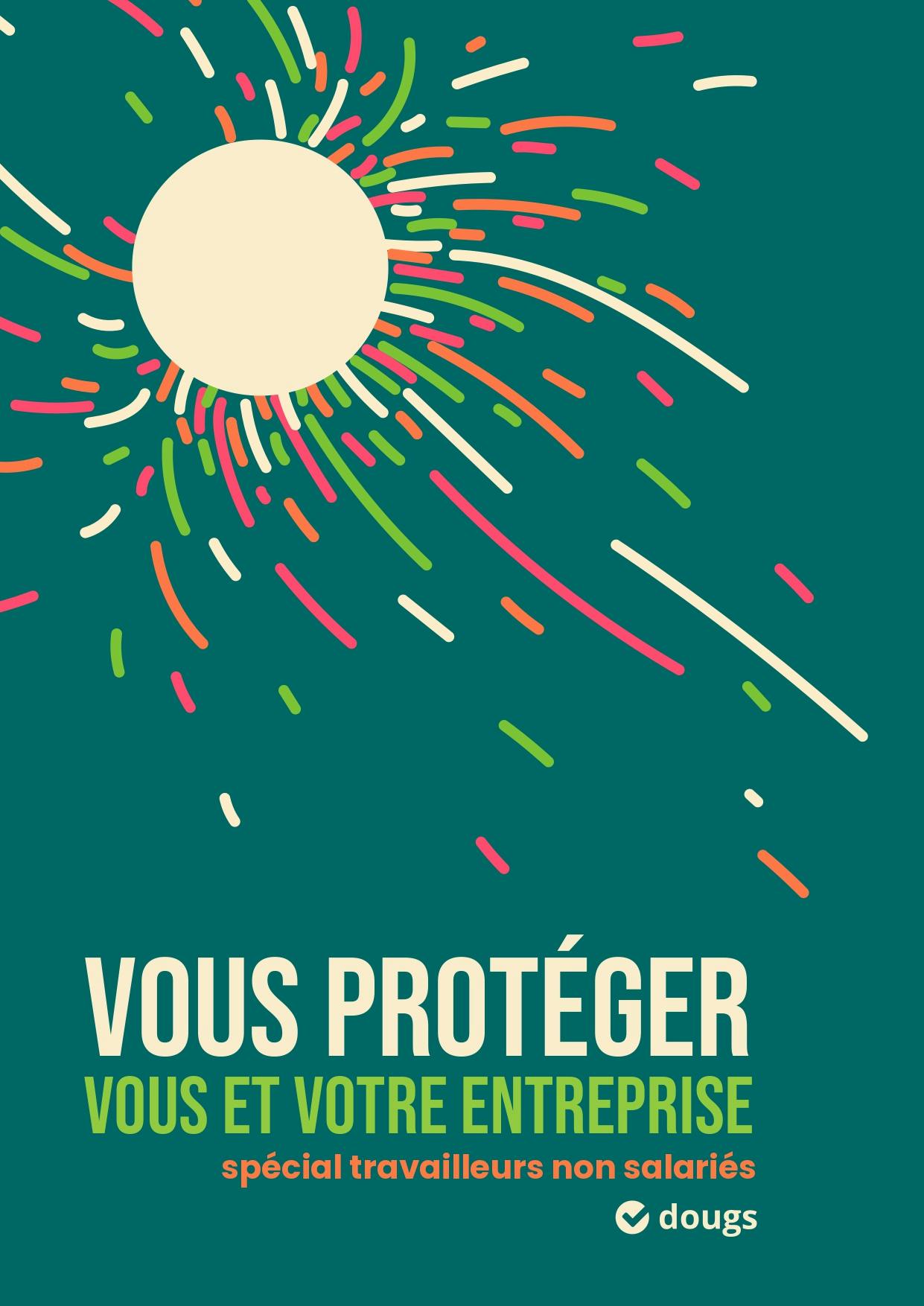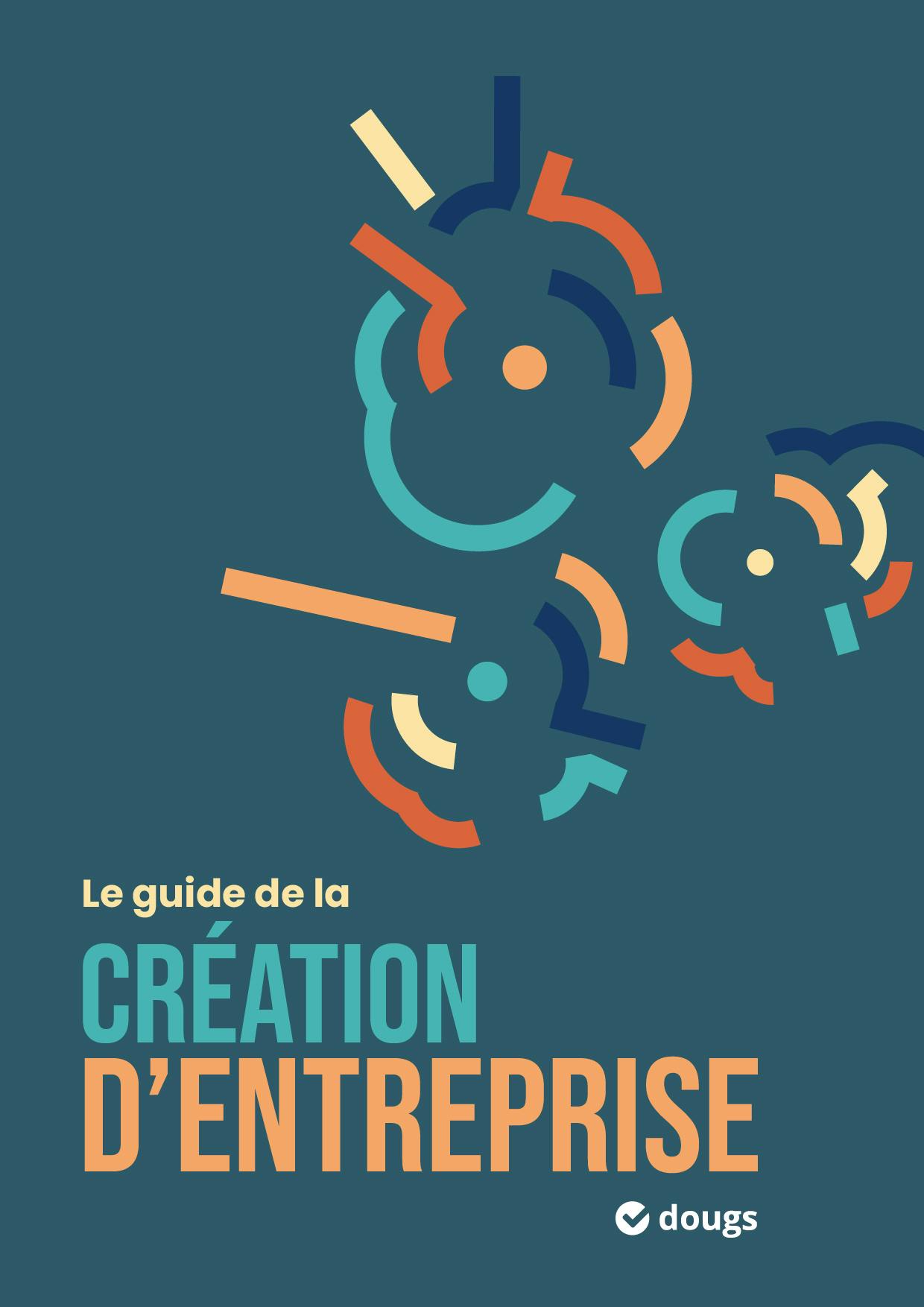Création d'une micro-entreprise : le guide détaillé

La création d'une micro-entreprise est une démarche passionnante qui ouvre la porte à l'entrepreneuriat et à l'indépendance professionnelle. Que vous ayez un projet qui germe depuis un certain temps ou que vous soyez à la recherche d'une nouvelle aventure, lancer votre propre micro-entreprise peut être une opportunité formidable. Cependant, cette étape nécessite de connaître les procédures à suivre. On vous explique chaque étape du processus de création d'une micro-entreprise en France et quels sont les coûts pour devenir micro-entrepreneur. Que vous soyez novice dans le monde de l'entrepreneuriat ou que vous recherchiez simplement des informations actualisées, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour vous guider tout au long de votre parcours entrepreneurial. Prêt à vous lancer ? Suivez le guide !
Découvrez comment choisir entre SASU ou micro-entreprise
- Rappel : quelle différence entre le statut auto-entrepreneur et micro-entrepreneur ?
- Quels sont les avantages de l'ouverture d'une micro-entreprise ?
- Quelles sont les conditions pour ouvrir une micro-entreprise ?
- Quels sont les coûts pour créer une micro-entreprise ?
- Comment créer une micro-entreprise (auto-entreprise) ? Quelles sont les différentes démarches ?
- Créer sa micro-entreprise en fonction de sa situation personnelle
- Checklist : tout ce qu’il faut pour créer sa micro-entreprise
Rappel : quelle différence entre le statut auto-entrepreneur et micro-entrepreneur ?
“T’es auto entrepreneur ? Ah bon… c’est pas plutôt micro-entrepreneur ?” On a tous entendu des personnes qui parlent de micro-entreprise et d’autres d’auto-entreprise. Quel est le terme à utiliser ? Et bien les deux sont valables. En effet, depuis le 1er janvier 2016, il n’y a plus de différence entre l'auto-entreprise et micro-entreprise.
Quels sont les avantages de l'ouverture d'une micro-entreprise ?
Les principaux avantages à la création d’une micro-entreprise sont les suivants :
- Des formalités administratives simplifiées : les étapes de la création d’une micro-entreprise peuvent s’effectuer en ligne rapidement, en quelques clics.
- Un coût limité : nous le détaillerons juste après mais le coût est l’un des principaux intérêts de cette structure car il est très souvent proche de 0 €. Cela permet d’ouvrir une entreprise et de d�émarrer une activité sans avoir une grosse trésorerie.
- Des obligations comptables simplifiées : elles sont très réduites par rapport à celles d’une société. Un micro-entrepreneur doit simplement tenir un livre-journal détaillant ses recettes et ses dépenses. Pas besoin de bilan ni de compte de résultat en fin d’année. Il doit également ouvrir un compte bancaire dédié à son activité. La souscription d’une assurance professionnelle est également vivement conseillée.
- Un cumul de revenus possible : il est possible de cumuler micro-entreprise et activité salariée ou allocations chômage ou retraite, sous certaines conditions. Cela permet d’avoir une activité complémentaire à vos revenus déjà existants (si vous avez plusieurs compétences ou passions par exemple) sans prendre de risque ni subir des frais trop importants.
- La possibilité de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA : c’est-à-dire que vous n’êtes pas redevable de la TVA, à condition de respecter les plafonds de chiffre d’affaires. En effet, cela vous permet de ne pas appliquer de TVA sur vos factures et donc de pratiquer des prix inférieurs, sans taxe (ce qui est un avantage par rapport à la concurrence). Et qui dit pas de déclaration de TVA à faire, dit gain de temps ! En cas de dépassement du seuil de la franchise, Dougs peut vous accompagner.
- Le choix entre imposition classique ou prélèvement libératoire : avant la création de votre micro-entreprise, vous pourrez opter pour le prélèvement libératoire de votre impôt sur le revenu ou rester à l’imposition classique. Sans cette option au prélèvement libératoire, vous serez par défaut à l’imposition classique selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (moins un abattement forfaitaire pour les frais professionnels). Toutefois, il vous sera toujours possible de revenir dessus et d’opter pour le prélèvement libératoire, sous réserve de conditions en matière de revenus, auprès de votre centre des impôts.
- Des charges sociales simplifiées et allégées, car elles sont calculées en fonction de votre chiffre d’affaires en appliquant un taux qui varie selon votre activité. Vous pourrez anticiper et donc connaître en avance les montants à payer.
- Des aides pour vous aider dans votre projet : de nombreux dispositifs sont mis en place pour aider le financement de la micro-entreprise. En fonction de votre situation et statut, vous pourrez bénéficier de dispositifs d’accompagnement comme l’ACRE (aide à la création ou à la reprise d’entreprise) ou l’ARCE (l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise), mais aussi d’aides financières, comme l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), etc.
Suivez 18 actions de cette checklist et optimisez dès maintenant votre tréso !
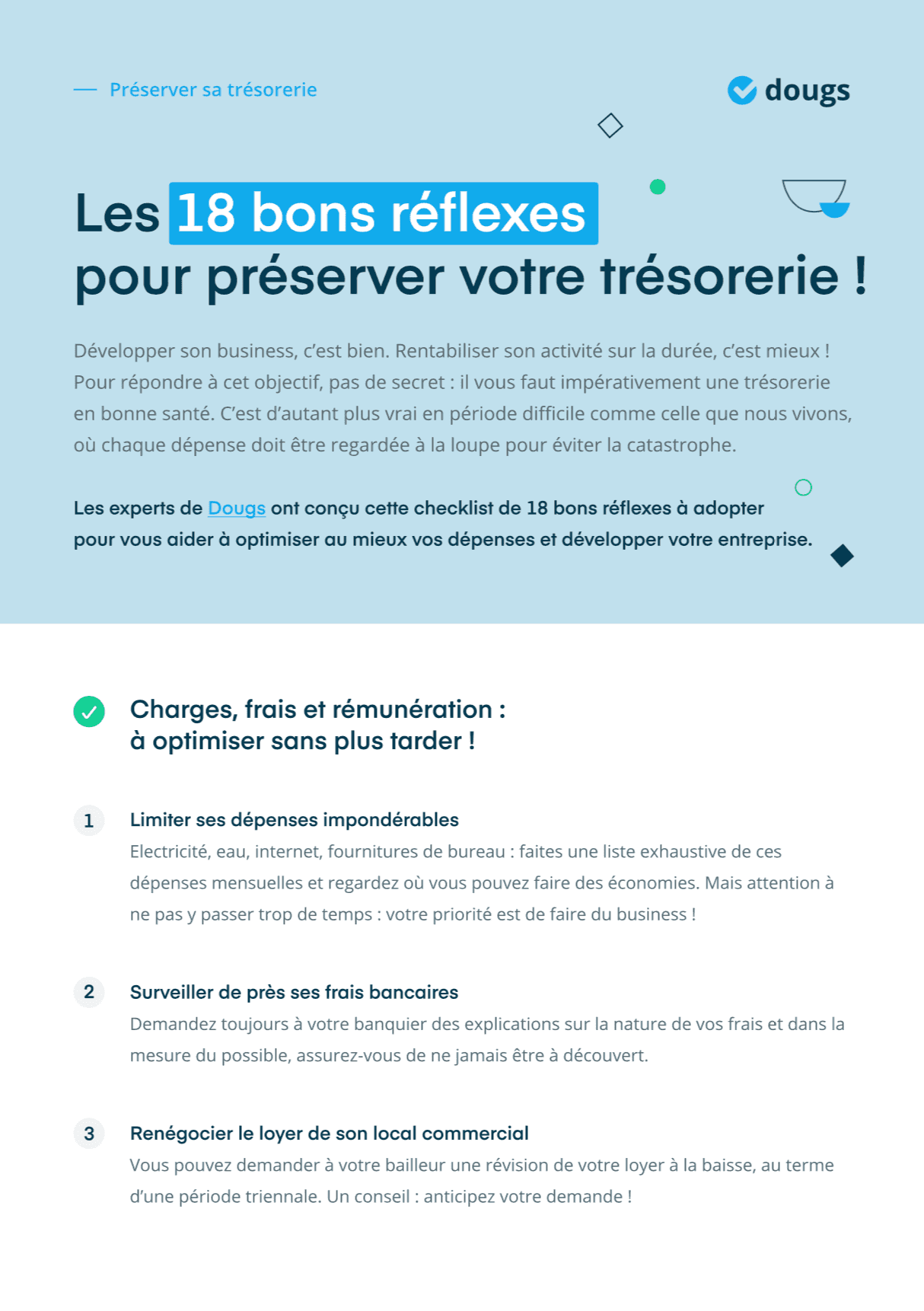
Quelles sont les conditions pour ouvrir une micro-entreprise ?
Les conditions liées au profil de la personne qui souhaite créer une micro-entreprise
Toute personne physique, par opposition à une personne morale (société, association, etc.), peut ouvrir sa micro-entreprise. Les conditions principales sont les suivantes :
- être majeur ou mineur émancipé : si vous êtes mineur non émancipé, vos tuteurs légaux doivent vous donner une autorisation de créer une micro-entreprise.
- ne pas être sous tutelle ou sous curatelle ;
- ne pas être condamné à une interdiction de gérer ou d’exercer une entreprise ;
- ne pas être inscrit en qualité de “travailleur non salarié” (TNS) sur une autre activité.
Les conditions liées à la nature de l’activité
En principe, un micro-entrepreneur peut exercer une activité artisanale, commerciale ou libérale, en tant qu’activité principale ou complémentaire.
Attention, certaines activités spécifiques ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise ou nécessitent de remplir des conditions supplémentaires (de qualification, de diplôme, sur autorisation, etc.). Ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise :
- Les professions libérales réglementées ne relevant pas de la caisse de retraite de la CIPAV ;
- Toute activité artistique relevant de la Maison des Artistes ou de l’Agessa ;
- Les activités relevant de la TVA immobilière.
À noter : les activités agricoles pour la partie culture de la terre, juridiques ou judiciaires, et les professions de la santé notamment, ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise.
Quels sont les coûts pour créer une micro-entreprise ?
L’immatriculation au RCS pour les activités commerciales, au RM (répertoire des métiers) pour les activités artisanales ou l’inscription à l’URSSAF pour les professions libérales est totalement gratuite.
Toutefois, si vous souhaitez vous lancer en micro-entreprise et devenir agent commercial, l’inscription au registre des agents commerciaux est obligatoire et coûte environ une vingtaine d’euros.
Il faut cependant s’acquitter des frais nécessaires pour les éléments suivants :
- l’ouverture d’un compte bancaire dédié à la micro-entreprise. Fortement conseillé et obligatoire si le chiffre d’affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives.
- la souscription d’une assurance professionnelle (vivement conseillé) ;
- la domiciliation de votre micro-entreprise, si vous décidez de faire appel à une société de domiciliation ;
- tous les autres frais liés au lancement de votre activité (frais liés au marketing, à l’achat de matériel nécessaire à votre activité, frais de formation, etc.).
N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous aider dans toutes ces démarches importantes qui peuvent nécessiter certaines connaissances juridiques ou comptables.
Découvrez comment choisir entre SASU ou micro-entreprise
Comment créer une micro-entreprise (auto-entreprise) ? Quelles sont les différentes démarches ?
Les conditions étant respectées, vous pouvez commencer à réaliser les démarches pour créer votre structure.
Pour cela, vous devez tout d’abord effectuer votre déclaration micro-entreprise. La démarche à suivre est relativement simple : il suffit d’effectuer une déclaration de début d’activité en ligne.
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les entreprises sont tenues d'accomplir leurs démarches par le biais du Guichet unique, administré par l'INPI. Ce système permet entre autres d'être enregistré au Registre national des entreprises (RNE), qui fusionne les registres préexistants.
Une partie des procédures prévues sur le Guichet unique de formalité des entreprises sont accessibles depuis le 30 juin 2023 et d’autres doivent encore être mises en place. Toutefois, une procédure de secours a été mise en place pour faire face aux éventuels problèmes rencontrés avec le Guichet unique de formalités des entreprises.
Dans ces formulaires en ligne, vous devez notamment :
- renseigner votre identité ;
- renseigner l’adresse à laquelle votre micro-entreprise sera établie ;
- indiquer si votre conjoint participe à votre activité (sur le statut de conjoint collaborateur par exemple) ;
- renseigner la ou les activités que vous souhaitez exercer en micro-entreprise.
Vous devez également choisir :
- Si le paiement de vos cotisations sociales se fera mensuellement ou trimestriellement ;
- d’opter ou non pour le versement libératoire ou rester au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Une fois la démarche effectuée, vous recevrez votre numéro SIRET, votre code APE ainsi que des notifications des organismes sociaux et fiscaux.
Ensuite, vous pourrez démarrer votre activité !
Créer sa micro-entreprise en fonction de sa situation personnelle
Devenir micro-entrepreneur et être salarié
Vous pouvez créer une micro-entreprise en étant salarié dans le privé en CDD ou en CDI. Vous n’êtes pas obligé de recevoir l’autorisation explicite de votre employeur mais certaines conditions sont à respecter :
- Votre contrat de travail ne doit pas contenir de clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité vous interdisant d’exercer une autre activité.
- Votre activité de micro-entrepreneur doit se faire en dehors des horaires de votre contrat de travail, mais vous n’avez pas de limite de durée.
Le cumul de plusieurs types d’activités (commerciale, artisanale et libérale) est possible.
Par exemple, vous pouvez vendre des ordinateurs (ce qui est une activité commerciale), en être le réparateur (cette fois, une activité artisanale) tout en exerçant une activité de consultant dans le domaine de l’informatique (une activité libérale).
Le cumul est possible si vous remplissez les 3 conditions suivantes :
- Vous exercez plusieurs activités différentes dans une seule et même micro-entreprise ;
- Les revenus sont cumulés dans une seule et même déclaration ;
- Vous payez une seule cotisation pour l’ensemble des revenus de vos différentes activités.
Lors de la création de votre micro-entreprise, vous devrez préciser dans vos déclarations quelle est votre activité principale et la ou les activités secondaires.
Créer sa micro-entreprise tout en étant au chômage
Vous pouvez cumuler les allocations reçues de la part de Pôle emploi et la micro-entreprise sous certaines conditions. Vos allocations sont maintenues partiellement s’il s’agit de l’allocation d’assurance chômage, de l’ARE (allocation de retour à l’emploi) et de l’ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise).
Est-ce possible de créer une micro-entreprise à deux ?
Il n’est pas possible de créer une micro-entreprise à plusieurs associés. En effet, la micro-entreprise est une forme d’entreprise individuelle : l’entrepreneur déclare son activité à titre de travailleur indépendant.
Micro-entrepreneur à 2 : comment faire ?
Il existe plusieurs moyens de contourner cela : via le groupement d’intérêt économique, le partenariat ou le statut de conjoint collaborateur (possible en cas de conjoint marié ou pacsé).
Conjoint – collaborateur
Si vous êtes marié ou pacsé, votre conjoint peut être déclaré comme collaborateur de votre micro-entreprise sous certaines conditions. Il vous sera toujours possible de modifier cela au cours de la vie de la micro-entreprise.
Créer sa micro-entreprise dans différents secteurs
Dans le milieu agricole
Il est possible, pour l’activité d’agriculteur, de souscrire au régime micro-BA (bénéfice agricole) sur les activités suivantes :
- L’exploitation de biens ruraux (fermages, métayages, faire-valoir direct) ;
- L’élevage d’animaux de toutes espèces (notamment les centres équestres) ;
- La vente de produits tous terrains propres à la culture et des produits de l’élevage ;
- Les recettes de la production forestière, de l’exploitation de champignonnières, de nouvelles variétés végétales, des revenus issus de la location de droits à paiement unique et des revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits issus de l’exploitation agricole ;
- Les apiculteurs, aviculteurs, pisciculteurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs et conchyliculteurs ;
- Les activités commerciales et industrielles accomplies à titre accessoire à une activité agricole.
La limite de chiffre d’affaires à ne pas dépasser est la moyenne des recettes d’exploitation sur les 3 dernières années : limitée à 85 800 € (seuil pour 2020, 2021 et 2022).
Depuis 2012, il est devenu possible pour l’agriculteur de créer une micro-entreprise dans la catégorie BIC ou BNC. Pour cela, l’activité qu’il exerce en tant que micro-entrepreneur doit être complémentaire de l’activité d’agriculteur tel que le conseil par exemple. Un agriculteur peut devenir micro-entrepreneur dans le conseil spécialisé dans la culture des terres. Les démarches seront les mêmes pour créer sa micro-entreprise.
Dans le bâtiment
Il faudra en plus de la démarche de création de micro-entreprise, attester de votre qualification professionnelle (en tant que plombier, peintre…) :
- Avoir un CAP ou un BEP ;
- Ou avoir travaillé au moins 3 années en qualité de travailleur indépendant ou salarié dans le métier.
- Vous pouvez aussi passer une VAE (validation des acquis de l’expérience), à voir avec la Chambre des Métiers et de l’artisanat.
Dans certains domaines, vous serez obligé d’immatriculer votre micro-entreprise au répertoire des métiers.
Il faudra obligatoirement souscrire à une assurance qui est indispensable dans le cadre de l’activité de bâtiment.
Checklist : tout ce qu’il faut pour créer sa micro-entreprise
Une petite checklist pour finir :
- Vérifier le cumul s’il s’agit d’une activité secondaire ;
- Vérifier si l’activité n’est pas règlementée et éligible à la micro-entreprise et ne nécessite pas des diplômes particuliers ;
- Ouvrir un compte bancaire dédié si cela est obligatoire en fonction du chiffre d’affaires prévu ;
- Souscrire à une assurance professionnelle (fortement recommandée) ;
Et enfin : créer sa micro-entreprise directement sur le site dédié en fonction de l’activité.